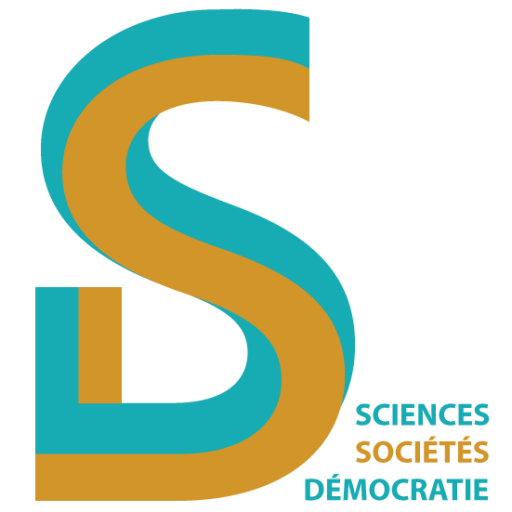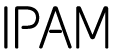Philosophe des sciences, activiste et professeure à l’Université Libre de Bruxelles, Isabelle Stengers est une figure hors norme dans le paysage intellectuel de ces quarante dernières années. Sa pensée interroge la production des connaissances par les sciences modernes et les visions du monde qu’elles conditionnent. À travers de nombreuses contributions, elle met en récit une vision résolument politique de la science et invite, avec malice et humour, à faire exister d’autres possibles, loin de la résignation et des schémas de pensées qui nous oppressent.
Au détour d’un passage par Paris, nous avons pu prendre un moment avec elle pour revenir sur les sources de ses engagements et sur sa vision des formes que pourraient prendre une alliance entre la science et la société civile pour dessiner les contours d’un nouveau rapport entre sciences, sociétés et démocratie.

Perdue pour la science
En revenant sur son parcours, Isabelle Stengers nous confie que les réflexions qu’elle développe sur la science prennent source dès sa formation, lorsqu’elle étudie la chimie à Bruxelles. Elle s’aperçoit au cours de son cursus qu’elle est formée à éventuellement devenir chercheuse en physico-chimie, mai sans vraiment « situer le front d’avancée de la discipline », c’est-à-dire en étant engagée à la faire avancer sur le mode de l’évidence. La manière dont les sciences lui sont enseignées ne laisse alors pas de place à des questionnements, mais seulement à la résolution de problèmes.
« En troisième année, je me suis rendue compte, un peu par le hasard des lectures, qu’en mécanique quantique il y avait d’énormes problèmes. Hors, je venais d’avoir un gros cours de chimie quantique et je n’avais pas vu de problème. »[1]
C’est sur la base de ces constats, qu’elle commence à s’interroger sur un certain nombre de « grandes questions » qui entourent les sciences expérimentales, et notamment sur le pouvoir normatif et disciplinaire des méthodes scientifiques. Elle réalise que la discipline qui organise et structure les communautés scientifiques empêche de prendre le temps nécessaire pour penser et prendre du recul et qu’elle mène plutôt à la compétition des disciplines et des chercheurs entre eux.
« Je me suis dit ‘Flûte, me voilà perdue pour la science !’ Je savais très bien que si je m’amenais avec des questions de fond, on me dirait ‘Mais qu’est-ce que tu fais en sciences ?’ »
Ces réflexions la poussent progressivement à s’engager pleinement dans l’étude de la philosophie des sciences. Elle s’adresse pour cela à l’un de ses professeurs, le seul qui lui semblait capable d’accueillir ses questionnements : Ilya Prigogine.
« Et il se trouve que Prigogine allait devenir, quelques années plus tard, Nobel de chimie[2]. Donc j’ai été embarquée, mais je n’en savais rien, dans cette histoire qui m’a menée à écrire avec lui ce qui est devenu “La nouvelle alliance”, qui est paru fin 1979 ».
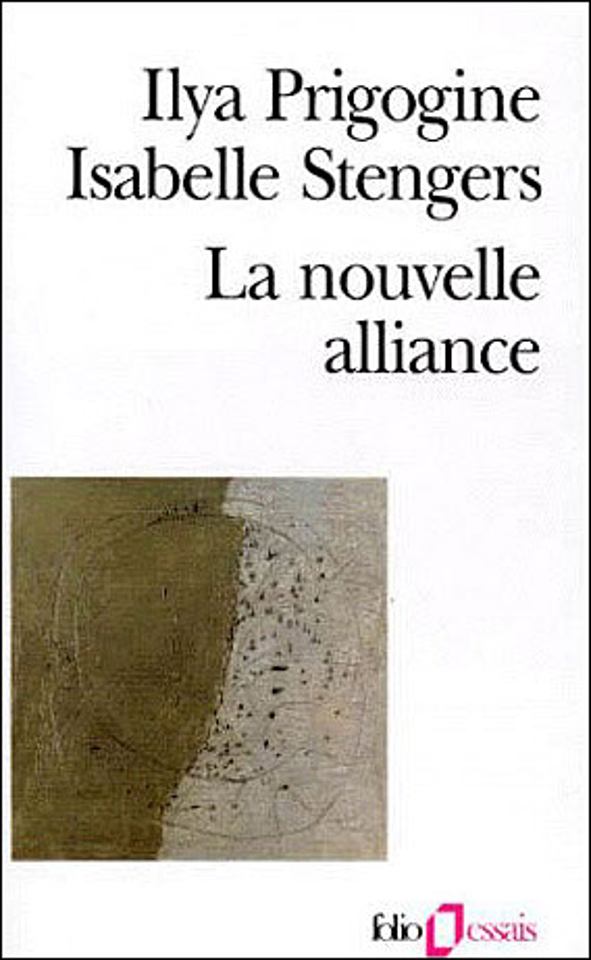
La Nouvelle Alliance est un véritable succès éditorial et anime de nombreux débats dans les années qui succèdent sa sortie. Ouvrage dense et complexe, mêlant histoire des sciences, réflexions philosophiques, et développements scientifiques techniques, il présente une métamorphose des paradigmes scientifiques par une transformation de notre perception de la nature. La science moderne a poursuivi l’idéal théorique d’une réalité déterministe et réversible, alors que le dialogue expérimental, y compris en physique, suppose l’irréversibilité et que l’ensemble des phénomènes naturels l’affirment. À travers ces développements, le livre formule une critique de l’hégémonie des sciences physiques. Cependant, cet aspect de l’ouvrage ne fût pas toujours interprété tel que ses auteurs l’ont voulu.
« Je me suis heurtée au fait que ce n’est pas parce qu’on a une idée qu’elle s’impose comme on voulait la formuler. En fait, ce livre a souvent été lu comme : « la bonne nouvelle, la physique nous autorise désormais à parler d’irréversibilité, d’événements, etc…» Donc exactement le contraire de ce qu’on essayait de faire passer… J’ai été frappée par la soumission intellectuelle de beaucoup de disciplines par rapport au modèle de la physique. »
Un peu atterrée, elle y voit néanmoins l’occasion d’aborder la question des savoirs scientifiques à partir de ce qu’ils rejettent et la manière dont ils disqualifient certains types de savoirs. Elle fait la rencontre de Léon Chertok, un psychiatre français vivement critiqué pour son travail sur l’hypnose. Cherchant à comprendre pourquoi l’hypnose subit une forme de répression de la part des psychanalystes, qui la considèrent avec dérision, elle s’aperçoit que les sciences humaines construisent souvent leurs savoirs sur une opposition à ce que les gens « croient » et peuvent ainsi très facilement devenir des outils de discipline sociale. Elles entretiennent un rapport presque « pastoral » à la société, missionnées de tenir le public crédule à l’écart des charlatans. Contrairement aux sciences expérimentales, dans les sciences humaines, bien souvent « la critique remplace l’objection ».
« Les scientifiques ont appris le mépris du public, notamment au contact avec les sciences humaines et sociales. Et c’est ça au fond qui a fait de moi une activiste. C’est-à-dire que l’hypnose m’a permis de comprendre à quel point la nécessité de tenir à distance un public, jugé trop crédule, habitait et empoisonnait les sciences. »
Philosophie et activisme :
Contre le mépris du public
C’est à partir de ces réflexions, et notamment de prises de position au moment où les OGM deviennent un véritable sujet politique en Europoe, qu’Isabelle Stengers dessine les formes de son activisme. Elle investit alors simultanément deux fronts : déconstruire les conditions matérielles et historiques de production des vérités des savoirs « dominants » et donner de l’écho aux savoirs « dominés ». À travers cela, c’est principalement la prétention à l’autorité de la science qu’elle remet en question, les fameux « il est prouvé que… » qui pullulent alors qu’une véritable preuve est un événement rare, qui interviennent partout où il s’agit de faire taire les désaccords. Le rôle de la science au service de l’ordre public constitue désormais pour elle un enjeu politique majeur[3].
« C’est un problème politique puisque le mépris du public, considéré comme un troupeau, c’est l’anti-démocratie par excellence. »
Elle prend alors part à différents mouvements visant à contester l’autorité de cette science dominante. Elle participe à des groupes anti-OGM en Belgique, et sera inculpée avec certains pour une action contre une Ïculture en plein champ, ou encore avec des collectifs, qui travaillent avec des groupes d’usagers de drogue non-repentis[4].
« Dans les années 90, mon premier travail proche des activistes, ça à été sur les politiques d’illégalité de la marijuana. J’ai pris appui sur l’exemple des Hollandais qui, à ce moment là, travaillaient avec les syndicats de drogués, les junkiebonden, pour fabriquer des dispositifs qui impliquent. Et ça a été un moment intéressant ; ces gens, dont on pensait qu’ils étaient des espèces de suicidés de la société, ont produit une véritable pratique politique. »
Pour Isabelle Stengers, la question est donc plus de développer d’autres types de savoirs et d’autres relations aux savoirs, en cultivant l’art des questions pertinentes que de chercher à tout prix à faire progresser la connaissance. Et pour cela, pour faire émerger ces bonnes questions, le levier essentiel semble être de provoquer des rencontres collaboratives. La science ne doit pas se poser comme une redéfinition des pratiques étrangères au champ scientifique mais comme une manière d’irriguer ces pratiques et d’apprendre d’elles et avec elles.
« Cela sous-entend de ne pas poser le problème comme un progrès ; le progrès c’est “avant/après…”. Il faut plutôt aller vers un “et ici…, et ici…” ; “et…, et…, et…” pas une temporalité d’avant/après. C’est cette temporalité qui a fait les pires dégâts. Au fond, il s’agit d’étendre le “et si…” expérimental, mais pas au labo : avec les gens. »
C’est aussi cette volonté de d’apprendre avec d’autres et grâce à d’autres, et de briser ce rapport pastoral de la science au public qui a amené Isabelle Stengers à se pencher sur les expérimentations de conférences de citoyens et la proposition de conventions de citoyens portée par l’association Sciences Citoyennes[5].
De tels dispositifs paraissent alors intéressants à expérimenter pour mettre les citoyens dans les bonnes conditions pour se rendre capables de se mêler de ces sujets. Elle reste néanmoins lucide sur le fait que ces instances ne s’obtiendront pas sans établir un rapport de force à la hauteur des enjeux qu’ils soulèvent.
« Pour moi, c’est quelque chose qui sera refusé au nom de la défense de la croissance économique, de l’innovation et de l’ordre public. Il faut s’en servir de manière expérimentale, et ne surtout pas s’étonner que cela ne soit pas une voie royale ouverte. C’est normal, ça gêne. Ça gène tous les intérêts établis. Donc c’est en tant que révélateur de “qui est-ce que cela gêne ?” que ça devient, dès aujourd’hui, intéressant. »
Mettre en mouvement les imaginaires
Avec toute sa malice, Isabelle Stengers nous invite à poser la question des sciences sur un mode qui permet d’activer l’imagination. Plutôt qu’une accusation essentialiste des sciences, elle appelle à s’en servir pour irriguer les possibles et penser comment les choses pourraient être autrement. Finalement, il s’agit en quelque sorte de se donner les moyens de se réapproprier les questions que pose la science et que souvent elle mutile.
« Cela nécessite de penser par le milieu. Les sciences aujourd’hui tout à la fois demandent et impliquent un milieu désertifié, pour qu’elles changent, leur milieu doit être repeuplé. Les choses peuvent aller vite, mais les pouvoirs n’accepteront pas cela spontanément, cela doit être reconquis. »
Elle appelle à créer des rencontres insolites pour faire des événements de ces sujets, leur permettre d’investir différents espaces – culturels, artistiques, médiatiques, etc… afin de les libérer des formes de pédagogie où on « explique », où on « partage » des savoirs fabriqués ailleurs. Ce qu’il s’agit de partager ce sont d’abord les problèmes politiques qu’ils soulèvent. À travers cela, c’est surtout l’occasion de prendre goût, et donc d’exiger, de nouveaux moyens de parler des savoirs et d’activer les imaginations. De construire la possibilité de faire autrement.
« Il y a des gens qui savent faire des “événements” de ces sujets. Je me souviens que, au début, avant que l’OMC ne soit créée, il y avait déjà le sinistre Pascal Lamy avec son “on n’arrête pas les horloges”. Mais si j’avais été artiste, j’aurais pris ce “on n’arrête pas les horloges” et j’en aurais fait une montagne ! J’en aurais fait une horreur telle… Il devrait y avoir des gens qui réussissent à fabriquer des espèces de ritournelles explosives. »

L’heure de tous (1975) de l’artiste français Arman Cour du Havre à Paris. Tous les cadrans des horloges y sont arrêtés.
À l’image de L’heure de tous, les terrains artistiques et culturels sont autant d’espaces à investir pour déconstruire ces hégémonies de certaines formes de connaissances. La place de la culture (entendue au sens le plus large) dans l’importance donnée à tel ou tel type de savoirs est primordiale pour faire exister des savoirs qui soient émancipateurs. À titre d’exemple, Isabelle Stengers mobilise la manière dont différents mouvements activistes ont entrepris des rapprochements pratiques avec des communautés indigènes dans la lutte pour la défense de leurs droits. Les croisements qui en résultent sont tout à fait intéressants pour dessiner les formes de nouveaux rapports aux savoirs.
Dans le même temps, il faut pouvoir se donner les moyens d’une science exigeante, où on ne peut pas laisser dire n’importe quoi. Un des rôles les plus pervers de cette institutionnalisation du rôle de pasteur est que les scientifiques ont parfois du mal à critiquer les travaux et promesses de leurs collègues, de peur que « les gens ne perdent confiance dans la science ». Il faut pouvoir trouver des moyens de déconstruire ces promesses et dérives. Et pour cela, la culture et l’humour sont des outils à investir en priorité.
« J’aime bien l’idée d’une “science responsable”. Parce que l’idée de “oh non, nous on veut continuer à être irresponsables” est assez dure à tenir. Il faut pouvoir rendre risibles les manières dont certaines positions se défendent. Parce que dénoncer est plus que facile, et on ne s’en prive pas. Mais apprendre à rire, à se moquer. Il faut le faire quoi, c’est une position qui offre une certaine prise. »
Propos recueillis et synthétisés le 18 juin 2019, actualisés le 25 avril 2023 par Edgar Blaustein et
Thomas Germain pour le processus SSD
Ressources :
- Wikipédia : Isabelle Stengers
- Editions la Découverte : Isabelle Stengers
- [Vacarme] Une politique de l’hérésie – Entretien avec Isabelle Stengers
- [Le carnet et les instants] – Isabelle Stengers. Philosophie activiste, récits spéculatifs et ouverture des possibles
- C’est notamment la lecture du livre « Les Somnambules » de Arthur Koestler qui provoque cette prise de conscience chez Isabelle Stengers. Dans son livre Koestler décrit une transformation des conceptions du ciel et du cosmos, depuis les Anciens jusqu’à Newton, et qui se conclut par une mise en parallèle entre l’astronomie pré-keplerienne et la mécanique quantique. Il suppose que la physique quantique est dans un état aussi instable que l’était l’astronomie née à Alexandrie : qu’elle attend un nouveau Kepler qui « brisera le cercle » et fera disparaître les « épicycle qui permettaient encore à Copernic d’attribue un mouvement circulaire aux planètes. Isabelle Stengers cherche alors à comprendre pourquoi elle n’a pas perçu ces problèmes lorsqu’elle suivait ses cours de mécanique quantique. C’est le point de départ de sa réflexion sur la discipline qui canalise l’imagination des scientifiques. » ↩︎
- Ilya Prigogine (1917-2003) est un physicien, chimiste et philosophe belge. Il a reçu le prix Nobel de chimie en 1977 pour ses contributions à la thermodynamique des processus irréversibles et spécialement à la théorie des structures dissipatives. Il a en particulier montré que quand la matière est éloignée de son l’état d’équilibre, elle peut s’organiser d’elle-même. De tels phénomènes se manifestent aussi bien en en physique qu’en biologie ou dans les événements climatiques de type tornade. Apparaissent alors des configurations nouvelles qui semblent contredire l’accroissement perpétuel d’entropie que prédit la thermodynamique mais Prigogine a montré que cet « ordre né du chaos » se paie par une dissipation (irréversible) d’énergie fournie par le monde extérieur. Comprendre la structuration des formes de la nature demande alors de s’adresse, à toute échelle, à des syst èmes ouverts, maintnus loin de l’équibre pat leur rapports à l’environnement. Source : Universalis.fr : PRIGOGINE Ilya (1917-2003). ↩︎
- C’est ce qu’elle fustige particulièrement dans Sciences et pouvoirs paru aux éditions La Découverte en 1997. ↩︎
- Isabelle Stengers et Olivier Ralet, « Drogues, le défi hollandais », Les empêcheurs de penser en rond, 1991. ↩︎
- Depuis 2005, Sciences Citoyennes porte un plaidoyer pour la mise en place d’un dispositif de conventions de citoyens. Plus d’information sur : https://sciencescitoyennes.org/convention-de-citoyens/ ↩︎